Monétisation des données personnelles : combien valent nos données ?
17 novembre 2025
La CNIL a commandé un sondage sur la perception des Français vis-à-vis de l’utilisation de leurs données personnelles et du consentement à la publicité en ligne. Ce deuxième volet d’une série de trois publications s’intéresse à leur inclination à utiliser leurs données personnelles comme monnaie d’échange.

Ces dernières années, des initiatives ont émergé autour de la « monétisation » des données personnelles, c’est-à-dire l’activité de « vendre » ses données comme une marchandise. Certaines proviennent d’entreprises privées ou de travaux de recherche académiques, mais d’autres émanent également du secteur public, notamment au Brésil via l’entreprise publique Dataprev dont l’initiative Wallet vise à faciliter la monétisation des données personnelles.
La CNIL rappelle qu’une pratique de « monétisation » de ses données personnelles, au sens de céder un droit de propriété sur celles-ci, n’est pas possible dans le cadre légal actuel puisqu’on ne saurait renoncer à ses droits sur ses données (droit d’opposition, d’accès etc.). La CNIL a déjà abordé ce point dans son article dédié aux murs de traceurs (cookie walls).
En théorie, il est toujours possible de céder un simple droit d’usage sur ses données et, sous certaines conditions, avoir recours au marché doit permettre de bénéficier d’une solution optimale. Ainsi, les individus qui attribueraient une valeur à leurs données inférieure à celle qu'elles ont pour l’entreprise pourraient les vendre : l’entreprise ferait un profit et l’individu enregistrerait un gain. À l’inverse, les individus attribuant une valeur plus élevée à leurs données que celle qu’est prête à leur payer l’entreprise n’en céderaient pas l’usage. Cette solution théoriquement optimale a notamment attiré l’attention de certains économistes (Bergemann et al., 2023) comme mécanisme de régulation de la vie privée.
En pratique, les individus sont-ils à l’aise avec la monétisation de leur vie privée ? Si oui, à quel prix et pour quelles données ?
Ces questions ont été étudiées par la CNIL, dans le cadre d’un sondage de Harris interactive réalisé en ligne du 18 au 23 décembre 2024, sur un échantillon représentatif de 2 082 Français âgés de 15 ans et plus.
La majorité des répondants sont prêts à vendre leurs données
65 % des répondants se disent prêts à vendre leurs données. Parmi eux, seuls 6 % seraient prêts à les vendre pour moins de 1 euro mensuel et 14 % souhaiteraient une rémunération supérieure à 200 euros mensuels. La valorisation la plus fréquente est entre 10 à 30 euros mensuels, privilégiée par 28 % des répondants.
En revanche, 35 % des individus ne souhaitent pas vendre leurs données, quel qu’en soit le prix. Cela traduit pour ces personnes un rejet de principe de la monétisation des données personnelles. Il coexiste donc deux rapports à la monétisation des données personnelles : pour une minorité d’individus, la monétisation de la vie privée est inacceptable et induit une perte de bien-être de manière indépendante du montant proposé en compensation.
Ce rejet du rapport monétaire devient d’autant plus saillant en croisant ces réponses avec celles abordées dans l’article « Les Français sont-ils prêts à payer pour des services en ligne sans publicité ciblée ? ». Il s’avère que 60 % des individus ne souhaitant pas payer pour des offres de services payantes leur permettant de mieux protéger leurs données personnelles ne souhaitent pas non plus vendre leurs données, peu importe le montant.
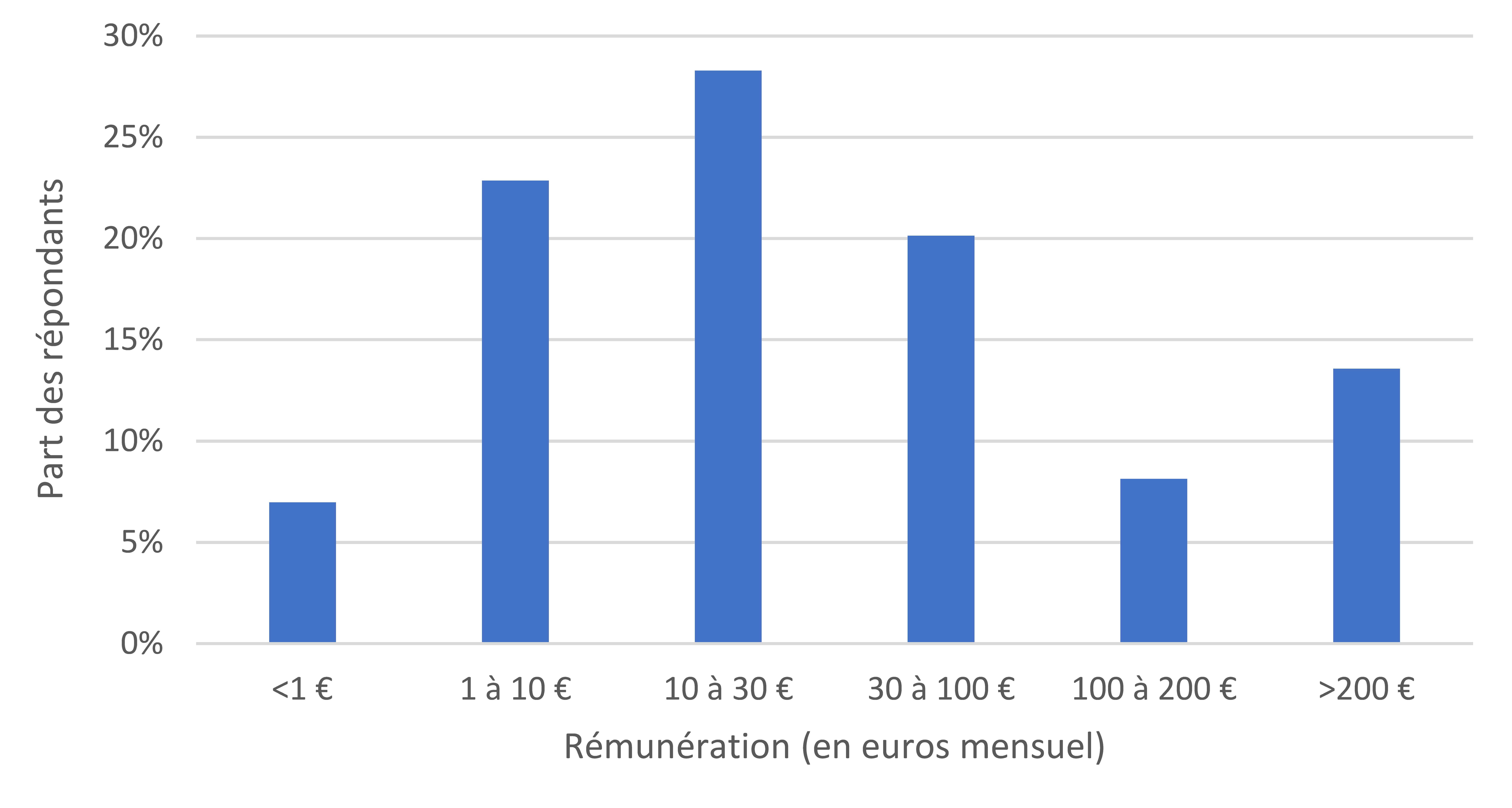
Montant théorique réclamé par les répondants en échange de leurs données
Une mise en balance économique des risques et des bénéfices
La majorité des sondés mettent en balance la menace perçue pour leur vie privée et la rémunération proposée, comme le prévoit la théorie du calcul vie privée (privacy calculus). Les répondants ayant tendance à déclarer des prix élevés sont également ceux qui déclarent accorder le plus d’importance à la vie privée en tant que critère de qualité d’un service numérique.
Ces résultats vont dans le sens de la littérature économique qui démontre l’existence d’un arbitrage des individus. On constate empiriquement que le prix augmente lorsque les données sont sensibles, si la finalité est la publicité, ou bien si les données partagées concernent également des proches, (Wessels, 2019, Friehe et al., 2025) mais également selon l’importance intrinsèque qu’accorde l’individu à sa vie privée (Schubert et al., 2021, Mager et Krantz, 2021).
Les répondants, via cette mise en balance, arrivent à un prix relativement borné, principalement compris entre 1 et 100 euros. En effet, parmi les sondés acceptant de vendre leurs données, 71 % sont prêts à vendre leurs données pour une somme située dans cette fourchette.
L’offre et la demande de données personnelles
L’article de Wernerfelt et al., 2022 "Estimating the value of offsite data to advertisers on Meta" étudie la valeur des données personnelles pour différents annonceurs du monde entier ayant recours aux services de Meta, ce qui permet de construire un exemple de courbe de demande estimée pour les données personnelles. Le graphique ci-dessous montre sur la courbe orange la part des individus prêts à accepter de vendre leurs données (axe vertical) selon le prix de vente proposé (axe horizontal) confrontée à la part des entreprises, indiquée en bleu, qui seraient prêtes à acheter ces données pour ce même prix.
Ainsi, pour un prix de 5 euros, 20 % des personnes seraient prêtes à vendre leurs données et 90 % des entreprises seraient prêtes à les acheter.
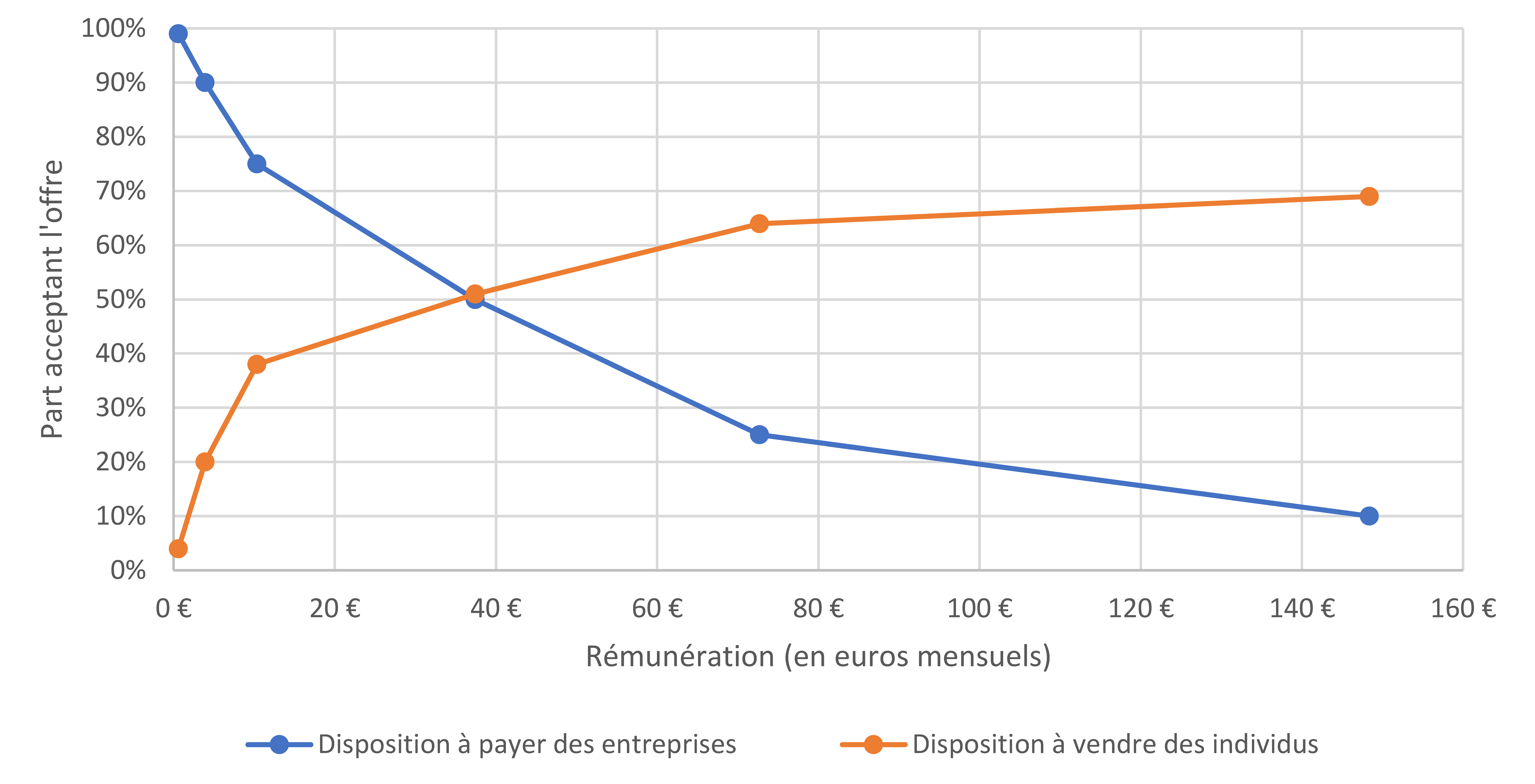
Courbes « d'offre et de demande » de données personnelles
Pris ensemble, ces résultats permettent d’approximer un prix de marché pour les données qui serait aux environs de 40 euros par mois (et par service souscrit).
Toutefois, la présence d’une minorité pour laquelle toute participation à un échange marchand de données personnelles engendre une désutilité intrinsèque qui conduit à constater que les dispositifs de marchandisation généralisée des données, malgré leur cohérence sur le plan de la théorie économique, ne pourraient pas être imposés à l’ensemble des individus sans engendrer une diminution du bien-être collectif.
On peut s’attendre à ce qu’une part des 35 % de répondants refusant de vendre leurs données soit en réalité prêts à l’accepter en échange d’une réelle rémunération. De la même manière, il est possible que le prix d’acceptation soit inférieur à 40 € en pratique. À titre de comparaison, dans une recherche en condition expérimentale réalisé en Allemagne, le prix de vente moyen pour obtenir un contact Facebook était de 19 euros (Benndorf et Normann, 2014) et entre 10 à 20 % des individus n’étaient jamais prêts à partager leurs données : les résultats du sondage réalisé par la CNIL sont donc assez proches.
Ils permettent donc de mieux comprendre le rapport des individus avec la monétisation des données personnelles, entre rejet de principe et mise en balance du risque pour la vie privée. Cette diversité souligne que l’importance que l’on accorde à la vie privée prend des formes multiples, qui ne peuvent toutes se limiter à une question de prix.





